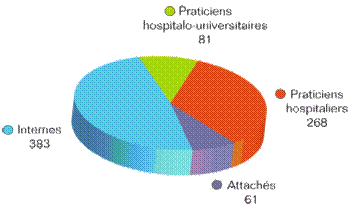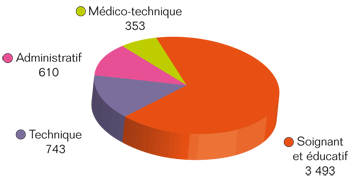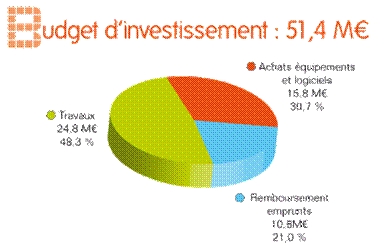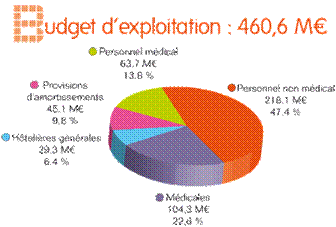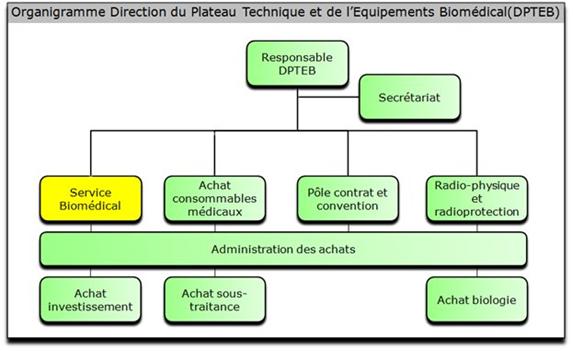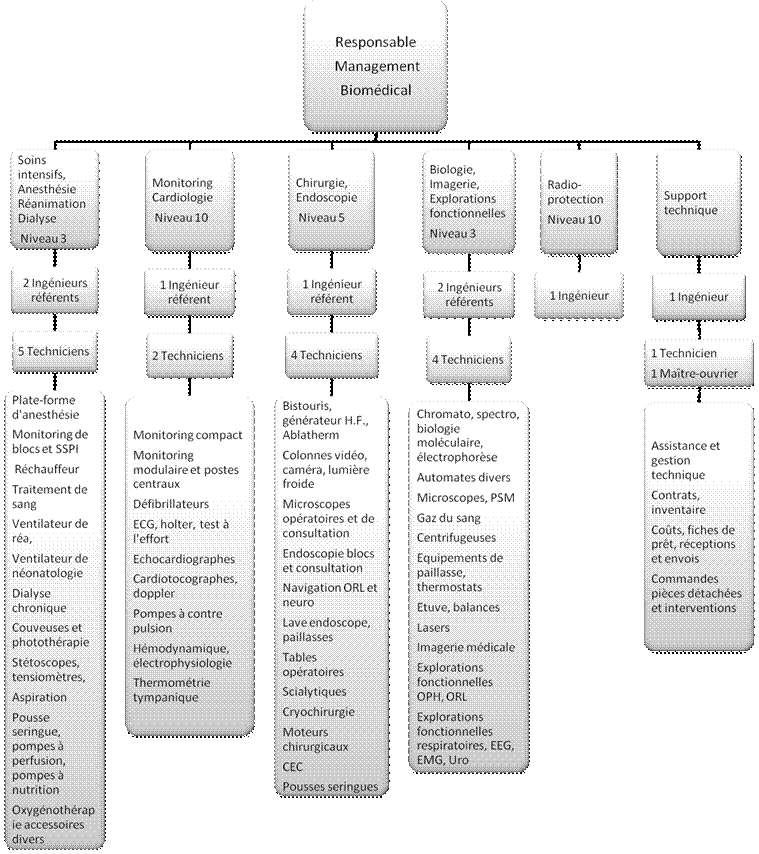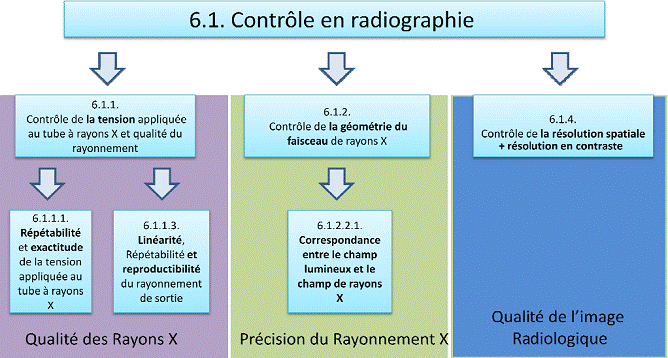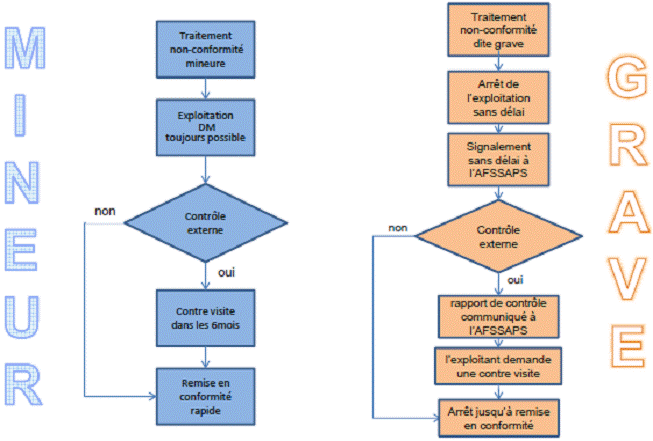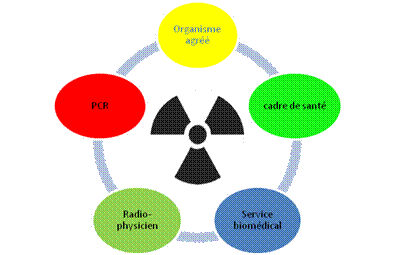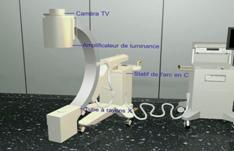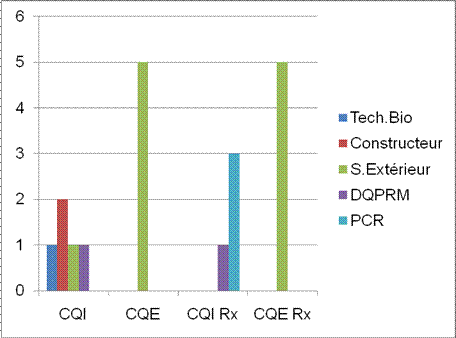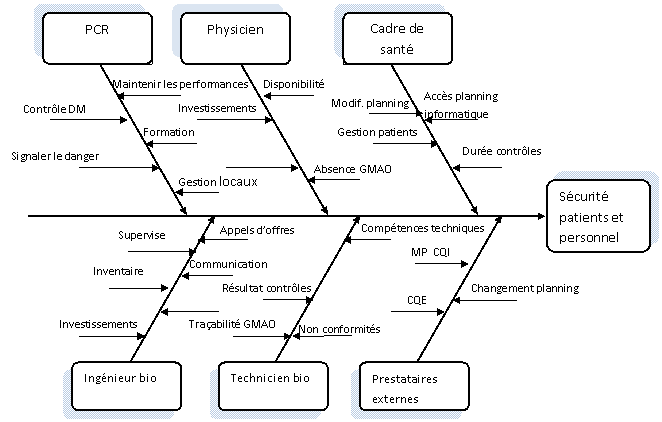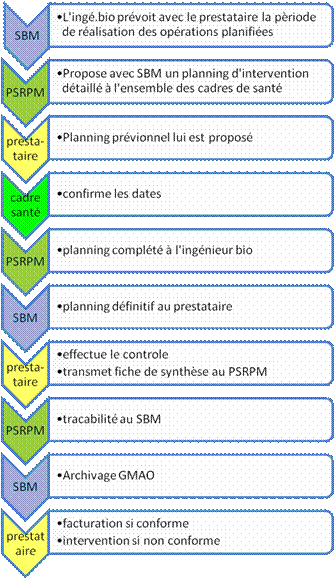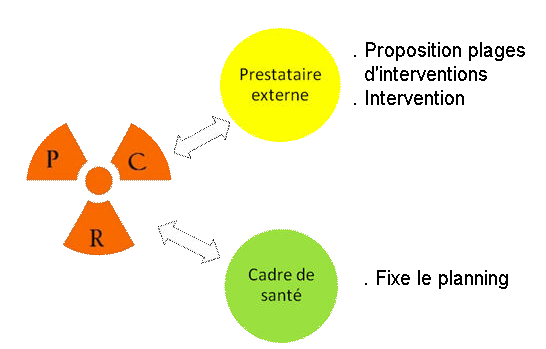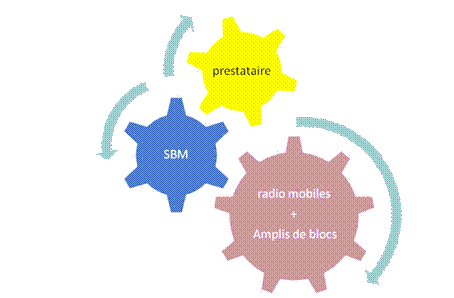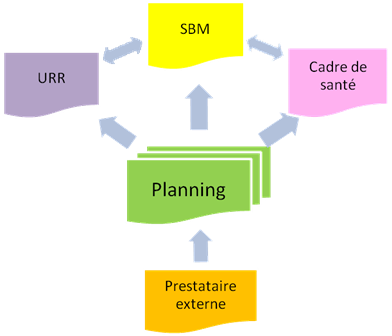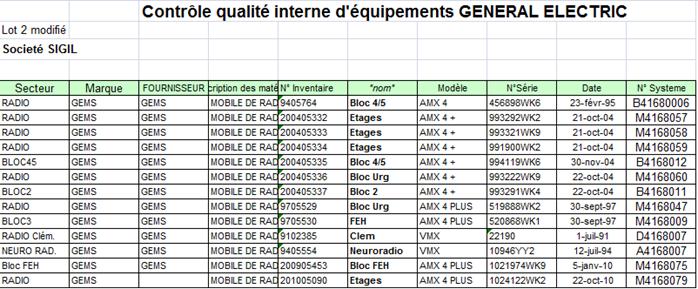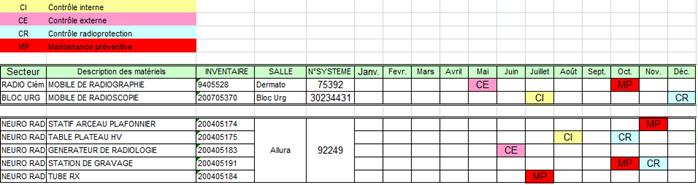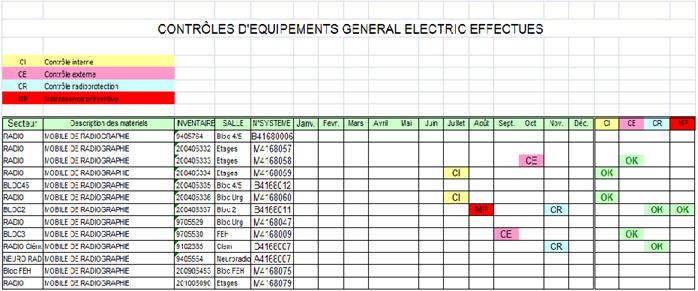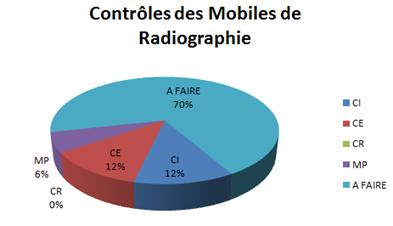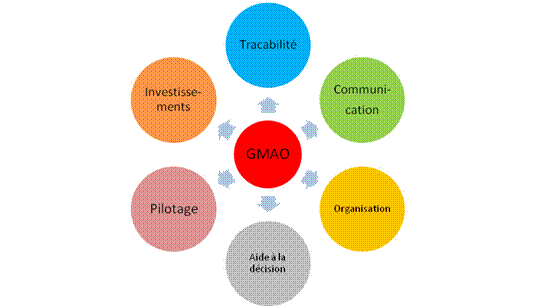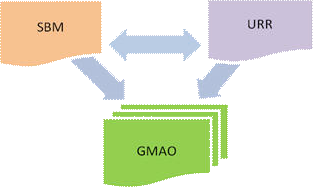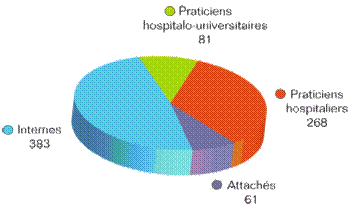
Figure 10 :
Répartition du personnel
médical [1]
Personnel non
médical : 5 199 Equivalents Temps
Plein
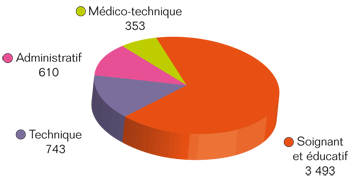
Figure 11 :
Répartition du personnel non
médical [1]
Budget
d'investissement
2008
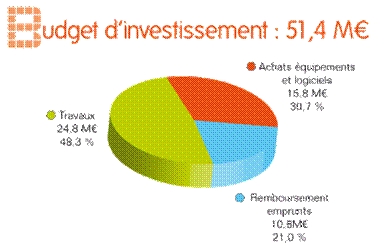
Figure 12 : Budget
d' investissement 2008 [1]
Budget
d'exploitation 2008
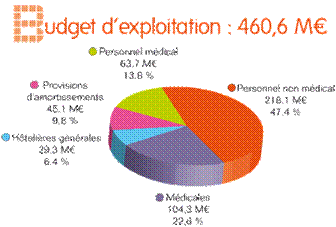
Figure 13
: Budget d' exploitation 2008 [1]
Equipement d'imagerie :
Blocs
opératoires :
1.5 Présentation
de la
Direction du Plateau Technique et de
l’Equipement Biomédical (DPMTEM)
La
direction du plateau technique et de
l’équipement biomédical
regroupe l’ensemble des activités
liées aux dispositifs
médicaux. Le service
biomédical appartient à
cette structure qui intègre
également les achats des
consommables médicaux non
stériles (hors pharmacie),
l’unité de radioprotection, les
contrats de maintenance et la gestion de
la sous-traitance, les aspects
administratifs.
Elle
se compose comme ceci
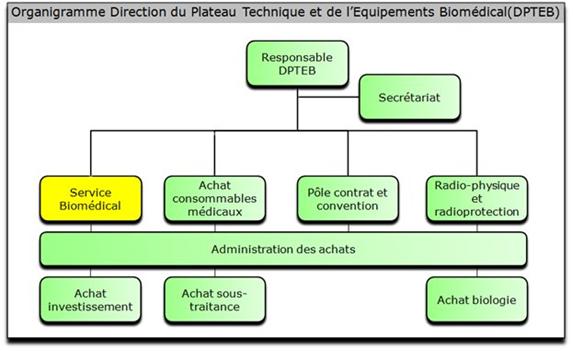
Figure 14 :
L'organisation du service DPTEB [13]
1.6
Le service biomédical :
1.6.1
Présentation et fonctionnement
du service biomédical :
Dans un premier temps, j’ai
rencontré une bonne partie des
ingénieurs et techniciens
biomédicaux ce qui m’a permis
d’avoir une idée du
fonctionnement du service
biomédical. Le
Service Biomédical est
localisé sur 2 sites (C.H.U. et
C.H.R.).
Les
ingénieurs biomédicaux
sont localisés au C.H.R. Seul
l’ingénieur de radioprotection
est localisé au C.H.U.
Ils ont chacun leurs
spécialités par
pôle (anesthésie,
réanimation, imagerie,
laboratoire, blocs opératoires,
dialyse, explorations fonctionnelles,
endoscopie etc.…)
Les techniciens sont
localisés au C.H.U. Cependant,
un technicien de maintenance de
dialyse travaille au C.H.R. Ils
travaillent par équipe (en
binôme) et ont
différentes
spécialités (imagerie,
laboratoire, chirurgie, dialyse
etc...).
Ils interviennent en fonction
de leurs compétences, certaines validées
par
des formations par les constructeurs.
Ce même fabriquant
précise le niveau des
techniciens nécessaire pour
effectuer la maintenance.
Une partie de la maintenance
est sous traitée comme
l’imagerie et les laboratoires. Le
technicien accompagne les intervenants
puis reçoit les comptes rendus
d’interventions.
Les données
d’organisation
pour la maintenance et le contrôle
qualité des dispositifs
médicaux permettent d’assurer
l’existence et la maîtrise des
éléments
généraux pour
réaliser ces activités.
Le
domaine d’application couvre la
maintenance et le contrôle
qualité des équipements
médicaux du CHU
de Caen pris en charge par la Direction
Plateau Technique et Equipement
Biomédical.
Le
personnel concerné est celui de
la Maintenance Biomédicale, de
l’Unité de Radiophysique et de
Radioprotection, ainsi que
l’ingénierie biomédicale.
Le
service
biomédical est composé
de :
ORGANIGRAMME
L’organigramme
fonctionnel et opérationnel de
la Maintenance Biomédicale
précise les champs de
responsabilité de chaque
intervenant.
Les
responsabilités sont par ailleurs
décrites dans les
différents profils de poste
des ressources concernées.
Le domaine
d’application couvre la maintenance et
le contrôle qualité des
équipements médicaux
du CHU de Caen pris
en charge par la Direction Plateau
Technique et Equipement
Biomédical.
Le
personnel concerné est celui de
la Maintenance Biomédicale, de
l’Unité de
Radiophysique et unité de
Radioprotection, ainsi que
l’ingénierie biomédicale.
Figure 15 :
organigramme
1.6.2 Rôle et
mission du service
biomédical :
-
La
gestion de la maintenance des
dispositifs médicaux.
-
La réalisation
de la maintenance curative et
préventive des
contrôles de
sécurité et de
performance.
-
La
gestion du parc d’équipements
médicaux.
-
La participation
à la formation des
utilisateurs
-
.L’élaboration
du plan d’ équipement
-
La
matériovigilance.
-
La
veille technologique,
réglementaire et normative
des équipements.
Chaque
technicien à accès
à la GMAO
(COSWIN 7.1) Ce logiciel permet la
gestion globale du parc des
équipements médicaux.
Aujourd’hui, les demandes
d’interventions se font principalement
par
téléphone. Cependant,
à
l’essai, des demandes
d’interventions sont
réalisées avec la GMAO dans les
services néonatalogie et les
laboratoires.La GMAO est un logiciel
puissant bien exploité dans
l’industrie. On le retrouve
fréquemment dans les SBM mais
pas de façon optimale dans les
services de santé. Pour
effectuer les différents
contrôles qualité et
maintenances, le SBM se doit
d’être équipé
d’appareils de contrôle qu’on
appelle ECME. Des
prestataires externes peuvent
intervenir, soit
par manque de personnel au SBM ou d’ ECME.
1.6.3 Inventaire
E.C.M.E. :
On
entend par ECME les appareils qui
permettent d’effectuer les
contrôles et maintenances des DM.
Quelques
ECME nécessaires
aux contrôles qualité en
radio diagnostique:
-
Marqueurs radio-opaques (fil
radio-opaque, pièces de
monnaie)
-
Règle à graduations
millimétriques radio-opaques.
-
Densitomètre. (Machine
à développer)
-
Sensitomètre. (Machine
à développer)
-
kVpmètre
(précision de 3 %)
-
Dosimètre (précision
de 5 %)
-
Mesure temps exposition (avec une
incertitude de 1 ms)
-
Jeu de plaques d’aluminium
(pureté au moins 99 %,
épaisseur 1 et 2 mm)
-
Fantôme équivalent
patient (section au moins 30 cm x 30
cm, épaisseur 20cm PMMA)
-
Jeu de plaques de cuivre
(épaisseur 2mm à 3mm)
-
Plaques radio-opaques couvrant la
surface de l’automatisme des
détecteurs de radioscopie
(épaisseur 2mm)
-
Objet-test pour le réglage du
moniteur préalablement au
contrôle de la
résolution spatiale et
de la résolution à bas
contraste.
-
Objet-test pour le contrôle de
la résolution à bas
contraste.
-
Mire de résolution spatiale
(de 0,70 à 5,00 pl/mm).
Mentionnons qu’au CHU
de Caen, les ECME ne sont pas
présent pour effectuer ces
applications puisque l’hôpital
utilise un prestataire extérieur
pour les contrôles
qualité, internes
et externes.
II -
LES OBJECTIFS
2.1
Les enjeux et la
problématique :
2.1.1 Législation :
La
maintenance des dispositifs
médicaux (DM)
est un sujet d’actualité,
d’autant plus que l’arrêté
du 3 mars 2003 rend obligatoire
la maintenance de certaines
catégories de dispositifs
médicaux.
L’employeur est
responsable de l'application du code
de travail et doit donc organiser la
radioprotection dans
l'établissement. Il doit mettre
à disposition de la personne
responsable de l’exercice d’une
activité nucléaire, tous
les moyens nécessaires pour
atteindre et maintenir un niveau
optimal de protection contre les
rayonnements ionisants.
Le contrôle
qualité d’un
dispositif
médical est défini comme
l’ensemble des opérations
destinées à
évaluer le maintien des
performances revendiquées par
le fabricant ou le cas
échéant, fixées
par le directeur général
de l’Afssaps.
Deux
types de contrôles de
qualité sont prévus par
le décret
2001-1154 : les
contrôles internes
réalisés par les
préposés de l’exploitant
ou sous sa responsabilité par
un prestataire externe et les
contrôles externes
réalisés par un
organisme de contrôle de
qualité externe
agréé par l’Afssaps.
Dans le tableau ci-dessous, on trouve
les différentes étapes
d’un contrôle qualité
effectué sur les appareils de
radiologie.
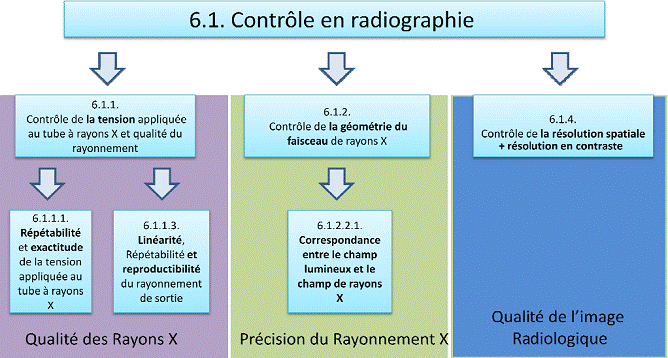
Figure 16
: Contrôle radiographie [2]
2.1.2 Les
enjeux :
Afin
de répondre au mieux à la
santé du patient et des
intervenants, il est obligatoire de
respecter les normes et le nombre de
contrôles qualité internes
et externes, les contrôles en
radioprotection et la maintenance
préventive des appareils de
radiologie.
Si le Directeur général
de l’AFSSAPS
prend connaissance que l’exploitant
d’un dispositif médical soumis
au contrôle de qualité
n’a pas mis en œuvre les
contrôles prévus, il met
en demeure l’exploitant de faire
procéder à ces
contrôles.
Le coût de la non qualité
est difficilement quantifiable mais il
est bien réel. Financièrement,
quand la qualité diagnostique
est insuffisante, il faut
recommencer les examens. Si la
qualité de l’image
radiographique est mauvaise, elle peut
donner une mauvaise
interprétation du
résultat
Concernant les risques,
la qualité d’une image
radiographique est dépendante
de la dose administrée, ce qui
entraîne une surexposition de
rayons ionisants qui nuit à la
santé du patient.
Organigramme représentant le
traitement en cas de non
conformités
Figure 17 : Non
conforme [2]
2.1.3
La
problématique :
Le
CHU comporte environ
50 appareils générateurs
de rayons ionisants qui sont
réglementés par le code de la
santé publique, fixant les
modalités par décrets.
Pour
ma part, je vais m’intéresser aux
appareils de radiologie conventionnelle,
les mobiles de radiographie et de
radioscopie.
Les
appareils de radiologie étant
bien spécifiques en raison des
différents contrôles
obligatoires, on peut imaginer la
difficulté à effectuer une
planification en raison de
l’immobilisation fréquente des
appareils.
Les
différents acteurs qui gravitent
autour de ces différents
contrôles sont :
-
l’ingénieur biomédical >
C’est
le plus intéressé par
l'assurance qualité. Il doit
impulser la démarche, en
démontrer la
nécessité et en faciliter
la mise en place.
-
le technicien biomédical > Le
contrôle
qualité doit être
effectué par un technicien
possédant une solide formation
technique, une excellente connaissance
des règles de
sécurité et
également un savoir-faire
biomédical.
-
le radiophysicien (PSRPM)
> défini
dans l’arrêté du 19
novembre 2004:
Estimation
des doses délivrées au
patient : Il s’assure que les
équipements, les données
et procédés de calcul
utilisés pour déterminer
et délivrer les doses et
activités administrées au
patient dans toute procédure
d’exposition aux rayonnements ionisants
sont appropriés et
utilisés selon les dispositions
prévues dans le code de la
santé publique.
- PCR >
Personne Compétente en
Radioprotection, obligatoire depuis
1986.
Pour
tout établissement
détenant ou manipulant des
sources de
rayonnement
ionisant (modifié par les
articles R231-106 du décret du
31 mars 2003 et R4456-1 du
décret du 7 mars 2008.
Ajoutons
que le radiophysicien et le PCR au CHU forment l’URR (Unité de
radiophysique et radioprotection).
-
Prestataires
externes >
Ils réalisent les contrôles
qualité. Pour les contrôles
externes, ils sont obligatoirement
réalisés par des
organismes agrées par l’AFSSAPS.
Pour
le CHU, les CQI et
CQE, son tous effectués par
des prestataires agréés.
Les
prestataires retenus suite à un
appel d’offres sont :
-
Société
SIGIL
-
Société
SOCOTEC
-
Société
MEDIQUAL
-
Cadre de santé >
Il s’occupe du management et de ses
patients. Il doit être
prévenu des contrôles
qualité afin de laisser les
salles à disposition.
Services
gravitants autour des appareils
ionisants
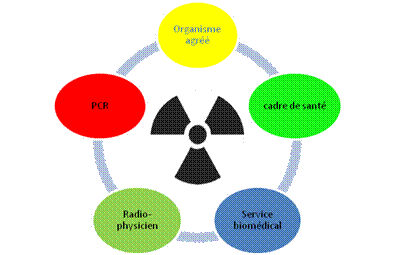
Figure 18
: Service gravitants autour des appareils
ionisants
2.2 Inventaire
des appareils soumis aux
contrôles et maintenance
-
mobiles de radiographie
-
mobiles de radioscopie
-
radiologie conventionnelle
Un
inventaire
complet de ces appareils ionisants se
trouve en annexe
Figure 19 :
Mobile de radioscopie Figure 20 :
Mobile de radiographie:


Figure 21 : Table
de radiologie capteur plan
Figure 22 :
Suspension plafonnière
Figure 23:
Poste de commande
générateurs suspension et
table
2.3 Opérations
concernées
« Art. R. 5212-26.
- En application de l'article L. 5212-1, la liste
des dispositifs médicaux soumis
à l'obligation de maintenance,
celle des dispositifs médicaux
soumis au contrôle de
qualité interne et la liste des
dispositifs médicaux soumis au
contrôle de qualité
externe sont arrêtées,
après avis du directeur
général de l'Agence
française de
sécurité sanitaire des
produits de santé, par le ministre
chargé de la
santé »
|
|
Obligation
de maintenance
|
Contrôle
qualité interne
|
Contrôle
qualité externe
|
|
Imagerie
ionisante
|
Par
l’exploitant ou sous sa
responsabilité
|
Par
l’exploitant ou sous sa
responsabilité
|
Par
un organisme indépendant
certifié par l’AFSSAPS
|
|
Classe
I degré faible de risque
|
|
|
|
|
Classe IIa
degré moyen
de risque
|
|
|
|
|
Classe IIb
potentiel élevé
de risque
|
Par
l’exploitant ou sous sa
responsabilité
|
|
|
|
Classe
III potentiel très
sérieux de risque
|
Par
l’exploitant ou sous sa
responsabilité
|
|
|
Pour
50
appareils ionisants au CHU
de Caen, on peut faire une estimation du
nombre d’opérations à
effectuer sur une année.
|
MP
|
CQI
|
CQE
|
CQE
Rx
|
TOTAL
|
|
80
|
50
|
50
|
50
|
230
|
Concernant la
maintenance préventive, nous
arrivons à 80 opérations
car certains appareils
nécessitent 2 maintenances
annuelles.
Dans
l’estimation,
la maintenance corrective n’est pas
prise en considération mais
elle génère
également des modifications de
planning des patients que le cadre de
santé doit gérer.
La
maintenance
préventive d’un dispositif
médical consiste en un ensemble
d’actions qui vont permettre de garder
ou rétablir les
fonctionnalités du DM.
Liste
de dispositifs médicaux
soumis à l’obligation de
maintenance en
radiodiagnostique :
Radiographie
et
radioscopie (fixe ou mobile,
conventionnelle ou
numérisée), scanner,
mammographie,
ostéodensitomètre,
injecteur de produit de contraste.
Négatoscope,
chaîne numérique.
L’article
D.665.5.2 du CSP propose
trois orientations à l’exploitant
pour la mise en œuvre de la
maintenance :
-
Réalisation
par
le fabricant ou sous sa
responsabilité
-
Réalisation par le
fournisseur de tierce maintenance
-
Réalisation par l’exploitant
lui-même.
Au cours de ces interventions, il
sera notamment procédé:
-
à
la vérification
systématique de l’état
général des
systèmes,
-
aux
contrôles de
sécuritéà
-
l’entretien spécifique des
différents sous-ensembles et
des parties mécaniques,aux réglages et
étalonnages
nécessaires
-
au contrôle
qualité images
-
à des
essais de fonctionnementà
-
l’information des utilisateurs et
des techniciens biomédicaux
si nécessaire.
On
entend par "contrôle
qualité" d'un
dispositif médical l'ensemble des
opérations destinées
à évaluer le maintien des
performances revendiquées par le
fabricant ou, le cas
échéant, fixées par
le directeur général de
l'Agence française de
sécurité sanitaire des
produits de santé ; le contrôle
de qualité est dit interne,
s'il est réalisé par
l'exploitant ou sous sa
responsabilité par un prestataire
; il
est dit externe, s'il est
réalisé par un organisme
indépendant de l'exploitant, du
fabricant et de celui qui assure la
maintenance du dispositif.
Le
rôle
de la personne compétente en
radioprotection (PCR)
est de s’occuper des fonctions
essentielles dans l’hôpital :
-
Etude
des postes de travail
-
Délimitation des zones
règlementées
-
Surveillance de l’exposition
-
Relation
avec les autorités
L’arrêté
du 26 octobre 2005 définit
les modalités de contrôle
de radioprotection en application des
dispositions prévues par le
code du travail et le code de la
santé publique.
Ces
contrôles sont menés par
la personne compétente en
radioprotection et au moins une fois
par an par un organisme
agréé pour ce qui
concerne le contrôle des sources
et appareils émettant des
rayonnements ionisants.
Afin de permettre l’évaluation
de l’exposition externe et interne des
travailleurs, un contrôle
technique périodique des
ambiances de travail doit être
réalisé. Ce
contrôle est également
conduit par la PCR et au moins une
fois par an il est confié
à un organisme
agréé.
2.4
Etat des lieux (qui fait
quoi ?)
Après un entretien individuel
avec chaque personne concernée
(radiophysicien, PCR,
Cadre de santé et
ingénieur biomédical),
cela m’a permis de mieux comprendre la
problématique. Une des
questions qui revient souvent de la
part de chacun est Qui
fait quoi
La raison de cette question est
due à un manque de
méthode et de mise en commun
d’outils partagés car les
attentes des différents
services sont différentes.
Pour
le radiophysicien,
il est évident que le
problème majeur est la
difficulté d’accéder
rapidement aux travaux
réalisés sur les
différents appareils d’imagerie.
En effet, pour pouvoir consulter
rapidement un dossier et connaître
son contenu, il doit pour cela reprendre
le dossier sur papier qui est
déjà archivé.
Un
exemple : L’ASN
a besoin de renseignements concernant
un appareil d’imagerie. La
difficulté pour le physicien
est de
donner une réponse
dans le plus bref délai par
manque d’accès à un
support informatique.
Pour
la PCR,
c’est différent. Effectivement la
PCR est
indépendante du service
biomédical , c’est elle qui
gère la planification de ses
contrôles qualité.
Cependant,
elle n’a pas accès à
la GMAO qui lui
permettrait de prendre connaissance de
l’état des DM
concernés.
Pour le cadre
de santé, nommé
récemment
à ce poste, il lui est difficile
de connaître l’origine de tous ces
contrôles qui engendre
fréquemment des modifications de
planning concernant ses patients.
Par
conséquent,
l’incompréhension et les
difficultés rencontrées de
chaque responsable de
service résultent bien
des difficultés à
organiser l’ensemble des
opérations.
Un
questionnaire
a été adressé
à plusieurs services
biomédicaux afin de savoir
comment ils procédaient dans leur
établissement. (Annexe n° 1)
Résultats
d’enquête auprès
d’ingénieurs
biomédicaux.
Diagramme
ISHIKAWA : Rôle des
différents services
2.5
Les contrôles par
étapes :
2.5.1
Les CQI et CQE pour radios
conventionnelles :
-
L’ingénieur
biomédical envoie
l’inventaire au prestataire
externe agréé qui
propose des plages d’interventions
-
L’ingénieur
bio adresse l’ébauche du
planning au radio physicien
-
Le
radio physicien prévient le
cadre de santé qui fixe les
dates précises
-
Une
fois le planning
complété, le radio
physicien le transmet à
l’ingénieur bio
-
L’ingénieur
bio retransmet le planning
définitif au prestataire
-
Le
prestataire effectue le
contrôle
et une fiche de
synthèse d’intervention est
transmise au radio physicien
-
Le
radio physicien transmet à
l’ingénieur bio qui
transcrit la
traçabilité sur la GMAO
-
Si
le contrôle est conforme
> facturation
-
Si le
contrôle est non conforme
>
intervention du
prestataire.
2.5.2
La maintenance préventive
-
La
société externe
propose un planning au cadre de
service
-
Si
le contrôle est non conforme
>
intervention du
prestataire.
-
Si
accord, planning transmis à
l’ingénieur bio
-
La
maintenance est alors
effectuée comprenant un
test complet de toutes les
fonctionnalités
-
Si
test non conforme retour en
maintenance
-
En fin
d’intervention, un compte rendu
est alors rédigé et
archivé dans la GMAO
2.5.3 Contrôle
de radioprotection
-
L’ingénieur
Radioprotection envoie
l’inventaire au prestataire
externe agréé qui
propose des plages d’interventions
(proposition de 3 semaines
bloquées)
-
La
PCR communique directement avec
les cadres de service pour
définir le planning
selon les critères
et les dates proposées par
le prestataire
-
Intervention
du prestataire externe aux heures
proposées par les cadres et
la PCR
-
Compte
rendu envoyé par le
prestataire à la PCR , analyse
et archivage papier
2.5.4 Les radio
mobiles et amplis de blocs :
Concernant les radio mobiles et
les amplis de blocs, le technicien de la
société adapte son
planning en fonction de leur
disponibilité. Le technicien
biomédical se charge de mettre
à disposition les appareils et
guide le prestataire.
2.6 L’amélioration
de la communication entre les services.
Conformément aux
objectifs, nous avons avancé dans nos
démarches. Chaque service est
conscient des lacunes actuelles c’est
pourquoi nous avons travaillé avec
motivation et efficacité. Le but
étant de rétablir une
communication optimale, des inventaires et
un planning a été mis en
place.
2.6.1
Les outils de planification
Afin d’officialiser une certaine
démarche à la communication
entre services et prestataires externes,
il est nécessaire d’établir
des procédures communes à
l’aide d’outils informatiques.
La
première étape est de créer sur
EXCEL un inventaire de la liste des
équipements à
contrôler. Celui-ci servira de
liaison entre l’ingénieur
biomédical et le prestataire
externe. Suite à cet inventaire le
prestataire adressera à
l’ingénieur biomédical ses
dates d’interventions.
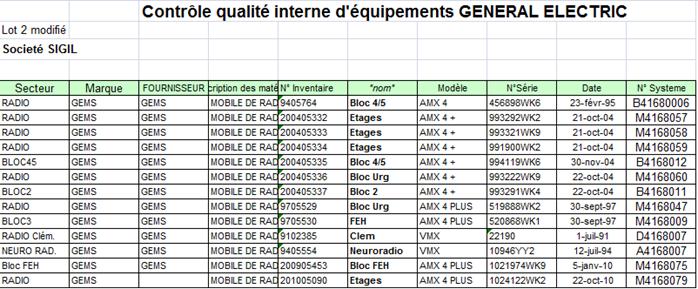
(Annexe n°2)
La
deuxième étape consiste
à concevoir un planning conçu
avec EXCEL qui pourra être
consulté par les services
concernés. Sur ce planning
l’ingénieur aura transcrit les dates
d’interventions du prestataire. Avec un code
couleur établi, il sera plus facile
de visualiser le type d’opération
concernée avec le
mois sélectionné.
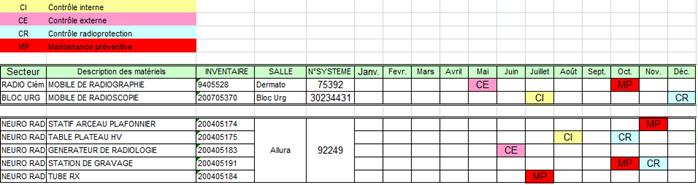
(Annexe n°3)
La
troisième étape, toujours
avec EXCEL, consiste
à interpréter à l’aide
d’un tableau et un graphique l’avancement
des différents contrôles
effectués.
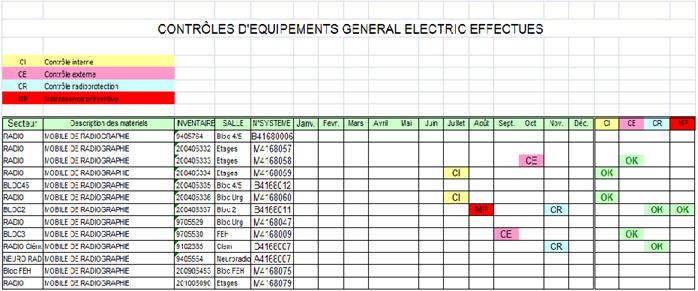
(Annexe n°4)
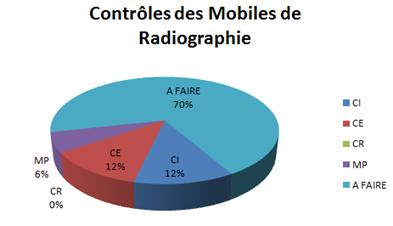
Figure 31: % Travaux
effectués
2.6.2
La traçabilité :
Aujourd’hui, le logiciel
idéal pour enregistrer et suivre
les interventions effectuées sur
les DM est la GMAO.
La GMAO est une
base informatique qui permet de disposer
en permanence d’un outil complet de
synthèse sur l’ensemble des
données de la fonction
biomédicale.
La sauvegarde
permanente des données est
assurée par la Direction du
Système d’Information. Sur ce logiciel,
on peut transcrire toutes les
informations concernant les DM.
Eventail des possibilités
de la GMAO :
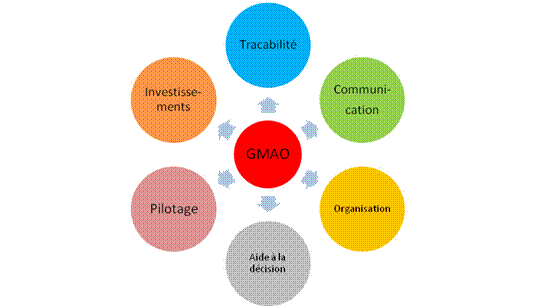
Figure 32 :
Eventail des possibilités de la GMAO
Inconvénient,
seul le SBM l’utilise pour tenir
à jour les informations
nécessaires au suivi du DM.
Pour remédier à ce manque,
une réunion entre les services
concernés a été
faite. Celle- ci s’est montrée
fructueuse car la démarche est
maintenant lancée pour que chaque
service ait accès à la GMAO
pour consulter les mises à jour
effectuées sur les DM.
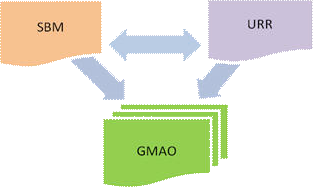
Figure 33 :
Représentation la mieux adaptée
Néanmoins, après
réflexion, en abordant le chapitre
sur la traçabilité, il s’est
avéré que la gestion des DM avec la GMAO
est complexe à mettre en place.
Chaque utilisateur devrait dans un premier
temps être formé sur ce
logiciel afin de l’utiliser au mieux selon
ses besoins .
De plus, nous sommes limités en
nombre de licences par rapport au nombre
d’utilisateurs, une licence étant
coûteuse.
Conclusion :
Ce stage effectué dans un service
biomédical en secteur public aura
été
bénéfique pour moi. J’ai
pu travailler durant ces semaines dans
une
structure plus importante que le service
biomédical où je
travaille.
Il
m’a permis de comprendre les
difficultés à planifier les
maintenances et les contrôles
qualité sur les appareils
d’imagerie.
Particulièrement
établir une cohérence entre
les services concernés dans
l’intérêt des patients et du
personnel.
Dans
un premier temps, la démarche
concernant un planning en commun
pouvant être visualisé et
modifié sur intranet serait
un aboutissement à
l’amélioration de la
communication entre les services.
De
plus, la GMAO
consultée par tous serait un
point fort pour que chaque
compte rendu d’intervention soit rendu
accessible, en particulier pour le
radiophysicien, la PCR
et le cadre de santé qui
à ce jour n’y ont toujours pas
accès.
Bibliographie :
[1] Site du CHU de Caen,
(consulté le 22.04.2011)
http://www.chu-caen.fr/
[2]
Site UTC-ABIH (consulté le
22.04.2011)
http://www.utc.fr/tsibh/moodle/course/category.php?id=4&categoryedit=on&sesskey=v3PtD2SsZ7
[3] Mise en pratique du
contrôle interne en radio
diagnostique, S. Payen, rapport de stage,
TSIBH, UTC, 2008,
(consulté le 30.05.2011)
http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/08/rapport_stage/stephane_payen/CQ_Radiologie.htm
[4] Contrôle
qualité en imagerie médicale
à modalité RX au
CHSF,A.Kwizera, rapport de stage, TSIBH,
UTC, 2009,
(consulté le 30.05.2011)
http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/09/stage/kwizera_a/rapport_html.html.
[5] Réglementation et
contrôle qualité en radiologie,
N.Maurel, rapport de
stage,MTS, UTC , 2008 , (consulté
le
20.05.2011)
http://www.utc.fr/~farges/master_mts/2006-2007/stages/maurel/maurel.html
[6] Optimisation de la
gestion des équipements
biomédicaux gérés
mutuellement par le service
biomédical et le Département
Patrimoine et Infrastructure, F.Laurent,
rapport de stage, TSIBH, UTC, 2008, (consulté
le 05.05.2011)
http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/08/rapport_stage/frederic_laurent/laurentfredericchucaen14.html
.
[7] Projet
d'intégration TSIBH, UTC, 2004-2005 Quelles
bonnes pratiques en contrôle
qualité en radiologie
conventionnelle ? (consulté
le 02.06.2011)
http://www.utc.fr/tsibh/public/tsibh/04-05/projets/mrad_rubambana/mrad_rubambana.htm
[8] Site de
l’AFSSAPS (consulté le
30.05.2011) :
http://www.afssaps.fr/Activites/Maintenance-et-controle-qualite-des-DM/Mise-en-oeuvre-du-controle/(offset)/5
[9] Démarche pour le
contrôle qualité de la chaine
imagerie en radiologie conventionnelle.
(consulté le 02.06.2011)
http://www.utc.fr/tsibh/public/spibh/1997/Stages/Robert/Robert.htm
[10] Articles R. 5212-1
à R. 5212-35 du Code de la
santé publique (consulté le
03.06.2011)
http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/vsv/vigilanc/dossiers/risques/doc32.pdf
[11] Contrôles en
radioprotection arrêté du 26
octobre 2005 (consulté le 04 juin
2011)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242968&dateTexte
[12] Support
de cours GMAO
(consulté le 09.06.2011)
http://www.utc.fr/~tsibh/moodle/course/view.php?id=192
[13] Réflexion
sur l’organisation sur la maintenance
biomédicale au CHU de Caen
–Propositions d’axes d’amélioration,
E.Vivier, rapport de stage, ABIH, UTC, 2010,
(consulté le 08.05.2011)
http://www.utc.fr/tsibh/public/abih/10/stage/vivier/Index.html.
Récapitulatif
des illustrations :
Figure_1: Plan
du CHU
Figure
2 : Fin des travaux
Figure
3 : Début des travaux FEH
Figure
4 : Ouverture de l’hôpital
FEH
Figure 5 :
Site Clémenceau
Figure 6 :
Le centre Esquirol
Figure 7 :
résidence pour personnes
âgées
Figure
8 : CHU Côte de Nacre
Figure 9 :
Hôpital FEH
Figure 10 :
Répartition personnel médical
Figure 11:
Répartition personnel non
médical
Figure 12 :
Budget investissement 2008
Figure 13 :
Budget exploitation 2008
Figure 14 :
Organisation du service DPTEB
Figure 15 :
Organigramme
Figure 16 :
Contrôle en radiographie
Figure 17 :
Non-conformité
Figure 18 :
Services gravitants autour des appareils
ionisants
Figure
19 : Mobile de radioscopie
Figure 20 :
Mobile de radiographie
Figure 21 :
Table de radiologie capteur plan
Figure 22 :
Suspension plafonnier
Figure 23 :
Poste de commande générateur
et table
Figure 24 :
Résultat enquête
Figure 25 :
Diagramme Ishikawa
Figure 26 :
Etapes CQI et CQE
Figure
27 : Etapes maintenance
préventive
Figure 28 :
Etapes contrôle Radioprotection
Figure
29 : Contrôle radio mobiles
et amplis de blocs
Figure 30 :
Amélioration de la communication
Figure 31 :
Pourcentage travaux effectués
Figure 32 :
Eventail des possibilités de la GMAO
Figure 33 :
Représentation la mieux adapt
Annexes
Annexe
1 : Fiche d’enquête
Annexe
2 : Inventaire équipement
appareils radio diagnostiques
Annexe
3 : Planning MP,
CQI, CQE, CQRx
Annexe
4 : Contrôle des travaux
effectués
Annexe
5 : Décrets N° 2001-1154
Annexe
6 : Décret R4456-1 du 7mars
2008 (Legifrance)